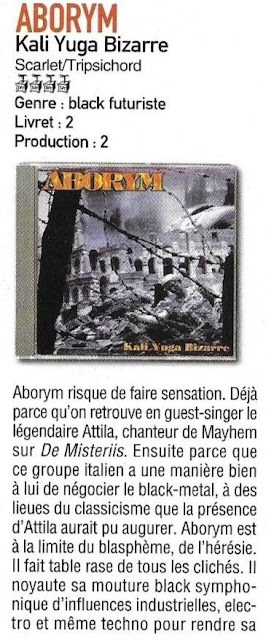Enforcer est un groupe de heavy métal suédois, faisant partie de la NWOTHM (New Wave Of Traditional Heavy Metal). Après quatre albums studio purs et assez virulents (les premiers flirtant même franchement avec le speed sans concession des années 80), Enforcer publie ce "Zenith" en 2019 et propose une variante de style assez prononcée. La cause heavy n'est pas reniée, et des passerelles permettent toujours au groupe de retrouver son passé musical assez cru, mais il est clair que ce disque "cul entre deux chaises" lorgne fortement vers les pans les plus mélodiques du hard et du métal...
Dès l'introductif "Die for the devil", c'est très clair : Enforcer a dans sa ligne de mire le Scorpions de "Rock you like a hurricane". Mais bon, passé l'effet de surprise, il faut bien admettre que le titre fonctionne et, malgré son côté caricatural, n'est pas ridicule.
Sur "Zenith of the black sun", on pense à la veine la plus commerciale de Judas Priest (période "Turbo" / "Ram it down"), avec une petite touche "Flight of Icarus" (la rythmique en cavalcade lente)... Étonnement mesuré, là encore, mais chanson intéressante et bien balancée.
Troisième titre : "Searching for you". Ici, on retrouve assez bien l'ADN habituel d'Enforcer (en beaucoup plus chromé). On avance encore : "The end of the universe", très réussie, fonctionne de la même manière, mais avec un profil héroïque assumé, tandis que "Thunder and hell" propose la dose de heavy speed linéaire et nécessaire.
Assez décousu tout cela, mais attendez, ce n'est pas fini.
Entre temps, les arpèges au piano de "Regrets" ont envahi l'espace. Le thème musical est beau, ingénieux, et la chanson évolue judicieusement en power ballade, mais sans jamais effleurer la puissance d'un "Still loving you" (ni même la puissance tout court). Malgré des qualités au départ, les planètes ne s'alignent pas vraiment, et, au final, on frôle l'indigestion.
Quelques encablures supplémentaires, et voici "Sail on" qui vient ratisser dans le jardin de Dio. Le rythme saccadé est atypique, intéressant, les chorus de guitare sont convaincants et il se dégage de cette chanson, coincée entre hard rock et heavy, un feeling détendu, positif, presque fun. On se surprend vite à fredonner le refrain, ce qui fait de "Sail on" une bonne réussite, même si l'on se doute bien que ce titre, assez léger et un peu "pirate metal" sur les bords, va diviser les fans.
En parlant de susceptibilité à ne pas trop titiller, une envie folle nous dicte de condamner d'emblée "One thousand years of darkness", dont les riffs sont maladroitement soulignés par des traits de claviers joufflus, typés AOR pire jus. Attendez donc le solo néo classique (guitare, puis synthé) : déboulant de nulle part, et plutôt virtuose, il pousse le morceau dans une autre dimension, et renvoie aux disques d'Yngwie Malmsteen parus dans les années 80, ce qui fait définitivement mieux passer la pilule... avant la sortie de route...
Un cocktail pop / rock occulte / glam mal dosé, et "Forever we worship the dark" ne parvient qu'à proposer une mauvaise parodie de Ghost, avant de s'enliser définitivement dans la crème au beurre. Énième changement de style (décidément Enforcer a vraiment eu des problèmes de boussole sur ce disque) : "Ode to death", titre aux prétentions grandioses, ascenseur vers un Manowar boursouflé (pas celui de "Black wind fire and steel", malheureusement), mais dont la cabine reste coincée entre deux étages, vers le bas de la cage, faute d'inspiration.
Une fin d'album assez malheureuse donc ; et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que le bonus track ("To another world") s'en tire, lui, assez bien, sorte de mix entre de bons riffs à la Priest et un refrain inspiré façon "Monstrance clock" (Ghost, mais on pardonne).
Souhaitons à Enforcer de tirer les leçons positives (il y en a, beaucoup même) ou négatives de son millésime 2019, et de poursuivre sereinement, avec lucidité, l'évolution qu'il a entamée.